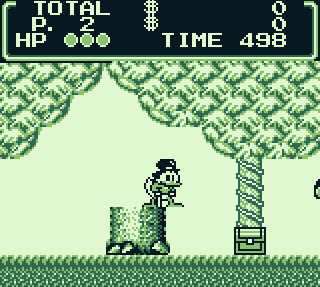Michael Jackson est le premier artiste dont j'ai reconnu le visage, puis le nom. Thriller est la première chanson que j'ai identifiée entre toutes les autres à la radio, et la première que j'ai fredonnée (pas chantée, Dora n'existait pas encore pour apprendre l'anglais aux enfants). Je n'ai jamais mesuré le succès de Thriller, je l'aimais tant qu'il me paraissait absolument normal de l'entendre tous les jours à la radio. Cette musique faisait partie de ma vie comme le centre commercial derrière chez moi, les tours multicolores de mon quartier et les Pierrot de mon papier peint.
Je ne connaissais pas non plus les scandales qui commençaient à poindre. La chirurgie esthétique, les caissons à oxygène et les folles dépenses ne retentissaient dans les média que lorsque j'étais couchée ou perdue dans un livre. Rien ne semblait souiller l'ange de blanc vêtu et son jeune tigre.
Bad est sorti sans que mes parents achètent l'album. Des amis leur avaient dit qu'il était nul et ils les avaient cru... J'ai d'autant plus de regrets que Bad comprend quelques chansons que j'adore aujourd'hui.

C'est Dangerous qui a fait de moi une vraie fan. J'étais une pré-ado pur jus, acnéique, renfermée, suivant la mode pour ne pas avoir à identifier mes propres goûts. Cet album, qui fut d'ailleurs le premier CD qui entra chez nous, devint rapidement un objet d'adoration, au point d'apprendre par cœur la majorité des paroles (je commençais à peine l'anglais), d'examiner à la loupe la pochette pour identifier la myriade de dessins et extrapoler leur signification à partir des innombrables articles qui remplissaient les colonnes de mon journal télé. Le journal de Mickey que je lisais assidûment me procura une biographie épurée de mon idole dans un dessin réaliste qui jurait avec les canards en barboteuse coutumiers de la revue, où Joe Jackson était un guide attentif. J'y découvris la Motown, Diana Ross et tout un pan de l'histoire musicale qui, jusque-là, ne m'avait pas intéressée.
Cette passion me tint plusieurs années. Je me fis offrir successivement un lecteur CD, puis Bad, Thriller en version CD (reléguant notre bon vieux vinyle au grenier), et Off The Wall. Je perfectionnai mon anglais, compréhension écrite, orale, et prononciation, en écoutant et braillant Billie Jean dans ma chambre, au grand désespoir de mes parents qui ont néanmoins regretté cette époque quand j'ai commencé à écouter de la techno.
Les scandales ont finalement tempéré mon enthousiasme. Je soutins bec et ongles que, si les accusations pesant sur lui avaient été vraies, les parents n'auraient jamais fait marche arrière pour de l'argent. Les moqueries dont sont capables les adolescents m'obligèrent toutefois à taire mon fanatisme. J'achetai sans m'en vanter History qui ne m'a guère transportée, puis Blood on the Dance Floor. Je tentai vainement de convaincre mes parents, qui ne croyaient plus à mon objectivité en la matière, que ce dernier album contenait quelques excellentes chansons.
Je passai mon bac, me lançai dans les études, et détestai Invincible. Les scandales s'empilèrent et pour moi Michael Jackson n'avait plus rien d'un ange. Il n'était plus qu'un fou que je plaignais pour son enfance et la pression des médias. J'en devins indifférente, et laissai mes CD prendre la poussière.
En 2007, alors que j'attendais mon fils, l'envie de renouer avec les passions de mon enfance et de mon adolescence devint irrésistible. Je me remis à regarder du catch, et à écouter ces vieilles musiques poussiéreuses, Polnareff, Simply Red, Cock Robin, Genesis, et Michael Jackson. Je fus séduite de nouveau. L'énergumène ne faisait plus guère parler de lui, même les médias s'étaient lassés de ses frasques, et dans leur silence sa musique paraissait de nouveau belle. Il n'y eut plus de moqueries, et s'il y en avait eu, je ne les aurais pas écoutées. Il me paraissait plus important que mon fils découvre cette musique. Je me réconciliai avec moi-même, je n'avais plus honte d'être une fan.
Et puis il y a eu ce matin de juin 2009, où je me suis réveillée dans une chambre d'hôtel allemande fournissant gracieusement un radio-réveil au son de Man in the Mirror. Je me levai avec le sourire, montai le son et me dirigeai en dansant vers la douche où je ne chantai pas trop fort pour ne pas réveiller mon chef dans la chambre voisine. J'ignorai les commentaires en allemand que je ne comprenais pas et me rendis à la réunion de travail pour laquelle j'étais venue. Je repris l'avion pour Paris l'après-midi même. Les haut-parleurs de l'aéroport de Stuttgart diffusaient Rock with you et des images de Michael Jackson, sous-titrées en allemand, peuplaient les écrans plats. Je m'en étonnai ; mon chef me rappela que des concerts étaient prévus. Je désirai de tout mon cœur y croire, mais l'abondance l'images, commune aux décès, me fit douter. En rentrant chez moi, j'entendis des jeunes filles parler de moonwalk et tentai de me persuader d'une coïncidence.
A mon arrivée chez moi, la télévision était occupée par Bambi (le film, que mon fils regarde au moins une fois par semaine). Ce n'est que lorsque ce dernier devint roi de la forêt que Claire Chazal apparut pour présenter un reportage sur la carrière de Michael Jackson. Mon mari m'apprit alors la nouvelle. Je retins avec difficulté mes larmes pour ne pas effrayer Alexandre. Je chantai à tue-tête en riant pour ne pas pleurer, et mon cœur se serra d'émotion en entendant mon fils reprendre Bad, ravi.
Dans les jours qui ont suivi, j'ai pleuré sans honte. J'ai été outrée d'entendre les mêmes médias qui l'avaient traité de fou et de pervers saluer son génie. J'ai été ravie des flash mobs, des hommages des fans, et de voir le nombre de personnes qui avaient été touchés à un moment ou à un autre, par sa musique. J'ai maintenant le droit d'être fan, la mort lave tous les soupçons.
Alexandre a maintenant à peu près deux ans, l'âge que j'avais à la sortir de Thriller. Michael Jackson est le premier artiste dont il connait le nom. Il l'a si souvent entendu à la télévision... Sa nounou et moi, sans nous concerter, avons réécouté Thriller très souvent. Mon petit bout réclame souvent de la musique, il sautille sur Jam, sur Beat It, il rit avec Vincent Price comme je l'ai fait. Ses yeux brillent de plaisir quand retentissent les premières notes de Wanna be starting something, son regard devient rêveur sur Heal the World. Peut-être se borne-t-il, comme je l'ai fait, à imiter sa mère. Peut-être est-ce juste le génie du musicien.